
Couverture du livre du philosophe Francis Wolff
(source Philosophie Magazine)
Le livre du philosophe Francis Wolff, professeur émérite à l’École normale supérieure, est l’ouvrage d’un écologiste, mais adversaire d’une écologie centrée sur « la vie » en tant que telle. Celle qui se développe notamment dans la foulée d’une critique de l’ontologie « naturaliste » occidentale, développée par Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, Bruno Latour, puis Baptiste Morizot, Vinciane Deprez et beaucoup d’autres. Son ouvrage a été écrit avant la seconde élection d’un Trump climatosceptique et l’auteur a hésité à le publier après. Il s’en explique en début de livre. S’il adresse des critiques à certains courants de la pensée écologique contemporaine, il tient cependant à rappeler que « l’adversaire unique, en la matière, demeure l’écoscepticisme sous toutes ses formes ». Comme j’ai développé des réflexions semblables dans plusieurs articles de Routes et déroutes, notamment à l’égard de Morizot et Descola, il m’a semblé pertinent de rendre compte de ce livre. Peut-on être écologiste militant non biocentré, c’est-à-dire humaniste ? Qu’est-ce que cela signifie ? Examinons l’argumentaire de Wolff, car l’affaire n’est pas si simple.
« … à force de vouloir expulser l’humanité de sa position dominante dans la nature, on finit par prêter à toute la nature les propriétés les plus convenues de l’humanité – quand ce ne sont pas les apologies du bon sauvage ou de la Terre-Mère. »
Francis Wolff, La vie a-t-elle une valeur ?
Le titre du livre, La vie a-t-elle une valeur ?, peut paraître choquant, mais l’auteur précise tout de suite qu’il ne s’agit pas de la vie humaine, mais de la vie tout court : « la vie nue », écrit-il. Et il illustre son propos par le livre Réparer les vivants de Maylis de Kerangal. Un adolescent en pleine santé est victime d’un accident et se retrouve à l’hôpital, le cerveau détruit. Le corps est maintenu en vie, « mais il n’y a plus personne ». Simon, le jeune homme, est mort. Que vaut sa vie « que nul ne vit » ? Les organes de son corps serviront à « réparer d’autres vivants », mais des « vivants humains » qui sont des personnes pouvant – grâce aux transplantations – « vivre leur vie ». En d’autres mots, quelle est la valeur de la vie sans conscience d’elle-même, la vie nue sans âme ?
On comprend rapidement les implications de cette question par rapport à ce que Wolff nomme « la pensée dominante de l’écologie » aujourd’hui, une écologie « biocentrée » pour laquelle la valeur fondamentale est la vie elle-même, qu’elle soit humaine ou non. Oui, me diriez-vous, mais selon d’autres ontologies dégagées par l’anthropologue Philippe Descola, tels l’animisme, le totémisme et l’analogisme, les vivants non humains sont également pourvus d’une « intériorité », ils ne sont dès lors pas que « physicalité » – c’est-à dire « vie nue ». Et davantage, même les existants abiotiques (rivières, montagnes, nuages, astres…) seraient dotés d’une intériorité. Seul le « naturalisme » des modernes occidentaux considère que les humains ont le monopole de l’intériorité. Voilà le responsable du colonialisme anthropocentriste. Comment Wolff va-t-il argumenter ?
Inflation du « Vivant »
Wolff constate que, « dans l’échelle des valeurs, la vie nue est aujourd’hui en hausse. Ce qui a la cote, c’est bien le vivant comme tel, par différence avec l’humanité dont la valeur est désormais dépréciée ». Et, de manière surprenante et intéressante, Wolff évoque dans un premier temps les mouvements chrétiens « pro-life » anti-avortement qui s’opposent aux « pro-choice ». Ce que les premiers défendent, c’est « la vie », ce qui est en opposition avec la tradition chrétienne traditionnelle qui « exhortait au salut de l’âme et exaltait l’existence spirituelle au détriment de la vie brute ». A telle enseigne que les Pères de l’Église et grands théologiens enseignaient « qu’il n’y avait pas de meurtre de l’embryon dans les premières semaines de grossesse » puisque l’âme ne s’était pas encore insinuée dans l’embryon en cours de gestation ».
Aujourd’hui, un courant dominant de la dogmatique chrétienne (sous l’influence des évangéliques aux USA) a quasiment inversé les valeurs : ce qui est précieux, quasiment absolu et sacré, c’est « La Vie » (titre d’un hebdomadaire chrétien). Wolff souligne « Ce qui vaut, bizarrement, c’est la vie sans âme ». Et cette apologie du vivant se retrouve quasiment à l’autre bout de l’échiquier politique, écrit Wolff. Soit dans ce qu’il appelle « la pensée écologiste dominante » et qui touche aussi bien les jeunes générations d’écologistes que les « Grands-Parents pour le Climat »[1]. Ce qui contraste totalement avec la pensée d’auteurs écologistes antérieurs, comme André Gorz ou Hans Jonas qui étaient « humanistes et anthropocentrés ». En résumé : « Aujourd’hui, c’est l’inverse : contre les méfaits commis par « les humains », il faut défendre et sauver « le vivant » » résume l’auteur. En précisant que « cette inflation du vivant est un phénomène surtout français ».







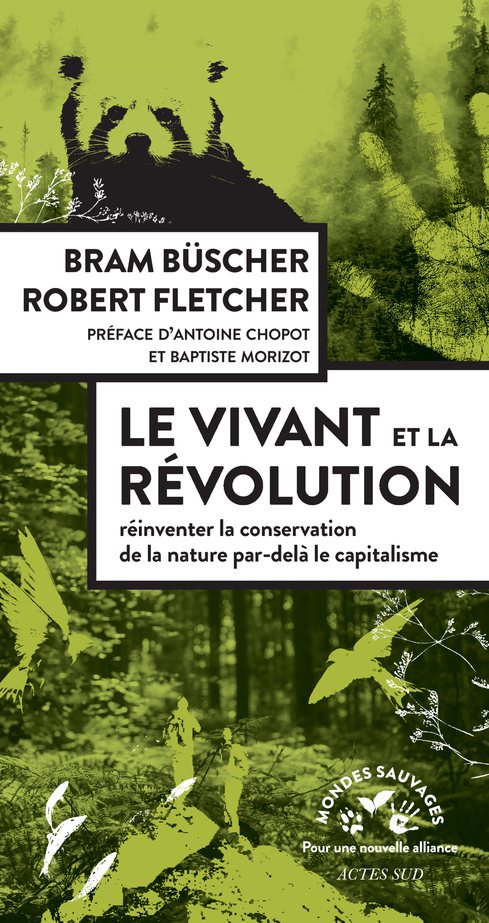

Quelques titres parmi beaucoup d’autres
(source éditeurs)
Peut-être, mais celui qui est considéré comme le père de l’écologie profonde et de l’écosophie non anthropocentrée occidentale est un alpiniste norvégien, Arne Næss. Voir aussi Aldo Léopold, ingénieur forestier américain et auteur de Penser comme une montagne (1944). On ne compte plus les titres qui s’inspirent du sien : penser comme un iceberg, être un chêne, autobiographie d’un poulpe, comment pensent les forêts, penser comme un arbre, etc. Les mouvements « pro-life » sont, eux, américains. Mais l’auteur se penche sur « le cas français » qui permet d’examiner une problématique plus générale à partir de ce dernier.
Si Wolff analyse à la fin de son livre pourquoi « la nature est passée à gauche » alors qu’elle a été longtemps une ressource de la droite, voire de l’extrême droite (notamment de certains nazis), voyons quels sont les avantages et les contradictions d’une « pensée du vivant ». L’auteur pose d’abord les jalons de sa réflexion en introduction de son livre, avant de les développer de manière documentée et argumentée ensuite.
Biocentrisme : le vivant contre la nature
Un premier avantage de la défense « du vivant » est de sembler être inclusive, dans la mesure où « peuvent s’abriter sous son aile » autant les « éco-anxieux » face à l’érosion de la biodiversité que les « antispécistes mobilisés contre la souffrance animale ». Notons en passant – et l’auteur y reviendra – que cette dernière est surtout provoquée par d’autres animaux. Sans parler des destructions du vivant opérées par des « existants non humains abiotiques » notamment des phénomènes naturels, tels tempêtes, sécheresses, inondations, météore responsable d’une extinction de masse, etc. Cinq des six plus grandes « extinctions de masse » sont non anthropiques. Le vivant et la nature sont meurtriers et conflictuels, ne l’oublions pas. Ils sont même écocidaires à leurs heures.
D’autre part, la notion de « vivant » permet d’évacuer celle de « nature », une invention des Occidentaux « naturalistes » et colonialistes des non-humains selon Descola et beaucoup d’autres[2]. Mais, observe Wolff, la notion de nature est beaucoup plus large que celle de vivant (chez les animistes, aussi, les « non-humains » comportent le monde non vivant) et inclut tout l’univers abiotique et permet, par ailleurs, « de définir, bien mieux que l’idée du « vivant », le domaine de nos devoirs écologiques ».
Le vice constitutif de la notion de « nature » serait d’être prise dans une dualité « humain vs nature » dont il conviendrait de sortir : l’être humain fait partie de la nature ; le concept de « nature » serait une invention de l’Occident, ce qui est « son pêché originel » destructeur de la planète. Wolff conteste ces deux points. D’abord parce que d’importants courants de pensée occidentaux affirment que l’homme n’est pas en « position d’exception » mais fait partie de la nature. Comme disait Spinoza cité par Wolff : « L’homme n’est pas un empire dans un empire ». Et, bien entendu, Darwin qui a « détrôné l’homme de sa position surnaturelle » et en a fait « une espèce animale comme les autres ». D’autre part, il n’y a pas, selon le philosophe Wolff, davantage de « science occidentale » que de « science orientale » (pas plus que de « science bourgeoise » et de « science prolétarienne »), mais seulement une science universelle.
Wolff remarque en passant que sans la science, en l’occurrence « la réduction de la nature à des données calculables, la climatologie contemporaine serait impossible ». Sans le GIEC, une collaboration de scientifiques du monde entier, on ne saurait rien ou pas grand chose du changement climatique. Il convient aussi de noter que, dans les sciences sociales, par exemple, l’opposition nature/cuture est fondatrice, car sans elle on ne pourrait dénoncer « la naturalisation du social ». En un mot, selon Francis Wolff, « le couple de concepts « nature »/ »culture » est politiquement puissant et émancipateur ».
J’avais naguère souligné, dans « L’écosophie pistée », l’usage et l’éloge que fait Baptiste Morizot de l’informatique et d’Internet dans le livre recensé (Manière d’être vivant) où il s’en prend par ailleurs à l’espèce humaine depuis la révolution néolithique : « Baptiste Morizot, comme il le dit, est un enfant de la modernité occidentale dont il a « hérité », qui fait grand usage de la technologie moderne, que ce soient les véhicules à moteur, les caméras thermiques pour pister les loups ou le numérique (il fait un singulier éloge d’Internet à la fin de son livre). Il est, en outre, un pur produit de la prospérité et de la technoscience européennes, notamment le darwinisme. » Et j’avais ajouté ceci : « En ce qui concerne ce dernier, son interprétation de la théorie des « convergences évolutives » qui détrône l’humain de sa position d’exception, me semble un peu biaisée, dans la mesure où il en déduit un potentiel évolutif uniquement favorable chez la moindre amibe, sans mentionner que lesdites convergences pourraient donner naissance aux mêmes catastrophes que nous avons connues, notamment écologiques. » (Bernard De Backer, L’écosophie pistée, je souligne)


Deux des nombreux livres au titre explicite
(source éditeur)
Le vivant, communauté morale ?
Revenons à Wolff. Selon lui, le principal argument en faveur du « vivant » est l’interdépendance des êtres vivants, ce qui est le b.a.-ba de la biologie scientifique : « la solidarité des éléments de la chaîne alimentaire est la condition même de la vie ». De ce point de vue, « l’écologie biocentrée » découvre la lune. Mais, le slogan « Nous les vivants » ne vise pas à attirer l’attention sur cette communauté de fait, mais bien sur une communauté souhaitable, morale : « nous devons être solidaires du sort de tous les êtres vivants (…) nous devons nous définir seulement comme des vivants (…) Le vivant est un. La vie, comme telle, est valeur ». (souligné par Wolff).
Il s’agirait là de la conséquence morale d’une révolution ontologique rompant avec l’anthropocentrisme du naturalisme prôné par l’Occident, abandonnant dès lors les hiérarchies entre les êtres, et particulièrement entre humains et non-humains. Il y aurait donc une « interdépendance morale » (et pas seulement biologique) entre les vivants. « Nous les vivants » ne désigne pas les humains affranchis du totalitarisme, comme chez Ayn Rand, mais la communauté morale des êtres biotiques.
Pour Wolff, la réponse est négative. C’est un des objets du livre, écrit-il. Mais il va au-delà : « … ce n’est pas en nous pensant, nous les humains, comme des vivants que nous pouvons penser, et encore moins combattre, ce qui nous arrive et ce qui nous menace. Ce n’est pas le vivant qui est menacé et ce n’est pas l’humanité qui est menaçante. C’est elle, l’humanité, qui est menacée ; c’est elle qu’il faut mobiliser (…) La morale humaniste et donc anthropocentriste[3] est la seule possible. Elle est aussi la seule souhaitable. Et l’objectif principal de ce livre est de contribuer à le montrer ». En d’autres mots, non seulement le vivant n’est pas une communauté morale, mais une écologie du vivant « est inefficace face à l’ampleur du désastre écologique », comme le dit Wolff dans son interview au journal Le Monde après la parution de son livre.
Le vivant devenu valeur intrinsèque
Dans son premier chapitre, Wolff se demande d’où vient la valeur, en dehors de celle déterminée par le prix du marché ? De Dieu et autres entités sacrées et fondatrices pour les sociétés religieuses hétéronomes, de l’humain pour les sociétés humaines autonomes, du vivant pour le biocentriste – « la pensée écologiste dominante » aujourd’hui. Mais comment la valeur est-elle arrivée au Vivant, après Dieu et l’Homme ?
Dans le christianisme, c’est en quelque sorte Dieu qui délègue la valeur suprême à l’Homme : « Faisons l’Homme à notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. (…) Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la » (Genèse, 1 : 26 – 28). Le « programme » qui débouchera sur l’anthropocène est donc bien antérieur aux Lumières et à la révolution industrielle. Outre le fait que l’on peut sans doute en trouver une version semblable dans d’autres traditions religieuses, force est de constater qu’il a été adopté aujourd’hui par la majorité du monde non occidental.
Avec la sortie de la religion en Occident, c’est l’homme qui a pris le relais comme origine d’une cosmologie anthropocentrée. C’est la naissance de l’humanisme. Pour qu’il y ait de la valeur et pas seulement de l’être, pense Kant invoqué par Wolff, il faut un être « apte à formuler des jugements moraux », ce que seuls des êtres humains sont capables de faire, affirme le philosophe. À moins que la vie ne soit elle-même, aujourd’hui, devenue « porteuse d’une puissance d’évaluation », qu’elle soit « elle-même une valeur ? » En d’autres mots, la valeur pourrait venir à la vie par elle-même, sans nécessiter l’homme. Elle serait une valeur intrinsèque, inhérente à elle-même, « en soi ». C’est le point de vue de l’écologiste biocentriste.

L’alpiniste et philosophe norvégien Arne Næss
(source Open air philosophy DR)
Processus, propriété, finalité
Le philosophe considère qu’il y a trois réponses distinctes à cette question, selon la manière dont on conçoit la vie : comme un simple processus dynamique, comme une propriété des vivants, comme la finalité interne des vivants. Si l’on examine la vie sous l’angle de sa dynamique, elle peut apparaître soit comme un processus global qui transcende les vivants singuliers qui n’en sont que les « rejetons », soit comme la caractéristique commune de ces êtres singuliers. Pour Wolff il faut examiner la vie sous ces deux angles conjointement : la vie globale et les êtres vivants singuliers. Son raisonnement est en arborescence.
La vie comme processus global s’incarnant dans des vivants particuliers (espèces, individus, collectifs vivants associant des espèces en symbiose…) est un phénomène « tardif et extrêmement localisé » qui n’occupe qu’une infime partie de l’univers et dont une grande proportion s’est éteinte à plusieurs reprises sur la Terre (les fameuses six grandes extinctions, dont les cinq premières sont non anthropiques). Malgré les cinq grandes extinctions « naturelles », la vie a repris selon l’auteur « dans une vaine et ahurissante richesse productive, une immense profusion et diversité aussi étonnante qu’absurde » (on pense à cette phrase de Shakespeare dans Macbeth : « It is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury. Signifying nothing. »). Mais d’une résistance exceptionnelle, car elle ne « vise qu’à être » : le but de la vie, une fois vivante, est de vivre ! Vue sous cet angle global, « La vie est ce processus indéfini qui transcende les organismes et les espèces ; elle se moque bien des vivants dont elle se sert pour se maintenir elle-même. Elle est sans valeur ».
Sous l’angle des êtres vivants singuliers, la vie peut être vue dans son rapport à l’être ou dans son rapport à la vie. Le propre de l’être vivant est « d’être capable d’assimiler des matériaux extérieurs pour les transformer en ses propres constituants (…) un être vivant transforme du non-soi en soi (…) Le maintien dans son être semble bien la finalité de l’être vivant. C’est ainsi qu’apparaît une valeur au sein même de la vie. Ce qui vaut, pour tout vivant, c’est soi ; le bien c’est le soi, c’est d’être soi encore et toujours ; le non-soi (l’étranger à soi) est mauvais ou neutre. Et s’il est bon (l’eau pour la salade, la salade pour le lapin, le lapin pour le renard, etc.), c’est à condition d’être assimilable, de pouvoir devenir un constituant de soi » (Wolff, souligné dans le texte).
En d’autres mots, la morale du vivant est égoïste : elle ne vise qu’à se préserver dans son être. De ce point de vue, pourrait-on dire, le vivant n’est pas plus « écologiste » que l’humanité. La diversité biologique (et non-biologique pour les plantes autotrophes) ne lui est utile que pour se maintenir. Certaines plantes et animaux sont « écocidaires » (il suffit de penser au gui – et autres plantes parasites – détruisant les arbres dont il se nourrit, et donc se suicidant de facto par manque de sève ; analogie instructive avec l’anthropocène). La morale humaniste désintéressée ne vaudrait-elle pas mieux que celle du « vivant » ?, se demande Wolff.
Quand à la reproduction du vivant, elle vise à créer hors de soi un autre semblable, perpétuant l’espèce (ou les informations génétiques) au-delà de la survie de l’individu. À travers les individus, les espèces ou les informations génétiques, « la vie ne cherche rien d’autre qu’elle-même (…) l’individu n’est pas une valeur pour la vie » écrit Wolff. Mais comme nous l’avons déjà laissé entendre, tout être vivant n’est pas un organisme individualisé. Ils peuvent être des « colonies », des « superorganismes », des symbioses (les milliards de bactéries dans notre intestin). Tout vivant n’est pas « un être », ce qui est une illusion anthropomorphique (difficile de s’identifier à un virus ou une bactérie). Conclusion de Wolff : « Hors des mythes anthropocentrés, la vie, le vivant, le monde n’ont donc ni fin, ni sens, ni valeur. Et cela ne fait guère une morale du tout ». Dont acte, mais ce n’est pas fini. Le biocentrisme résiste…
Reste, en effet, la vie comme finalité du vivant. Plus une force brute ou aveugle, mais une fin en soi. La vie n’est plus un processus ou une propriété, elle est le but du vivant, la valeur suprême, « un bien absolu du point de vue des êtres vivants en particulier ». (Wolff, souligné dans le texte). « Vivre est une valeur intrinsèque pour le vivant ». Ce concept de « valeur intrinsèque » (qui vaut en soi, opposée à « valeur instrumentale ») est central pour la pensée écologique dont il est question. Nous revenons dès lors à la question qui a précédé cette partie sous la plume de Wolff.
Après Dieu (ou toute forme d’extériorité sacrée) puis l’Homme, c’est la Vie qui prend la place de valeur surplombante, « un bien absolu ». Elle tient lieu de nouveau « Grand Autre » pour des humains modernes (d’où la majuscule parfois accordée à « Vivant ») ne supportant pas un monde désenchanté et dénué de sens. Et, de plus, la vie serait une valeur intrinsèque pour tous les vivants : « nous devons nous extraire de notre étroite perspective humaine et embrasser une vision globale du vivant, afin de nous mettre à la place des autres membres de cette communauté morale » – comme, sans jeu de mot, Baptiste Morizot se met à la place du loup en le pistant –, tel est le point de vue biocentré résumé par Wolff.
« Si l’on respecte la vie, elle cesse »
C’est sur ce point que Wolff va porter son estocade. En effet, la vie comme valeur suprême partagée par tous les vivants est une contradiction en soi, car ils ne peuvent précisément la partager : « Les uns ne peuvent posséder ce bien qu’à condition d’en priver les autres ». Et Wolff cite à ce propos la célèbre boutade de François Ier à propos de Charles Quint, « Quelle harmonie entre mon frère Charles et moi, nous partageons la même valeur (Naples) ; ce qu’il veut je le veux aussi. »
Que vivre soit la valeur commune de tous les vivants n’implique nullement leur harmonie en tant que vivants. La vie se nourrit d’autres vies pour vivre ; elle est cannibale. La vie n’est donc pas une communauté morale : « Le « respect de la vie » est une expression contradictoire. Si l’on respecte la vie, elle cesse. Si tout vivant respectait tout autre vivant, il n’y aurait plus de vivant – si ce n’est les « producteurs primaires », les vivants autotrophes que sont les plantes ou les phytoplanctons. Tous les autres vivants se nourrissent d’autres êtres vivants. » (Y compris certaines plantes carnivores ou parasites, sans parler de la concurrence lente et silencieuse entre elles : pour la lumière, l’eau, les ressources du sol, etc.). Cela n’empêche pas des collaborations de nature diverse entre vivants.
Comme le rappelle à juste titre Wolff, l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé des humains est en bonne partie le résultat de la lutte contre d’autres vivants : les bactéries, les virus… Avec l’aide, notamment, des biens nommés « antibiotiques ». « Tout le monde a le droit de vivre » disent les écologistes du Vivant, mais il faut bien choisir, écrit Wolff : « Le champignon du sol (…) ou la betterave sucrière qu’il attaque ? Les frelons asiatiques ou les abeilles ? Les coronavirus ou l’humanité ? Les éléphants du Botswana (car ils sont défendus par les ONG environnementalistes du monde entier) ou les paysans (véritables vaincus de la mondialisation) dont ils ravagent les récoltes et qu’ils réduisent à la misère ? ».

Éléphant du Botswana
(source TV 5 DR)
La réponse est dans la question, dans le sens où c’est l’humain qui prime pour l’humain (sauf si la dévastation du vivant le menace dans son existence). D’ailleurs, ajoute Wolff, « même le biocentriste, s’il est sérieux, devra concéder qu’une vie humaine doit être préférée à celle d’un loup, d’un agneau, d’un chêne, d’un roseau, d’une bactérie. (…) Il devra finalement se résoudre à une échelle de valeurs anthropocentrée ».
C’est d’ailleurs ce qu’écrivait Philippe Descola, comme nous le notions dans notre recension de Par-delà nature et culture pour La Revue nouvelle (juillet 2012) : « Comme le rappelle l’anthropologue dans un texte récent[1] : À qui appartient la nature ?, « Yellowstone est souvent présenté comme ayant été vide d’Indiens lors de sa fondation, la légende officielle voulant que ces derniers aient éprouvé une peur superstitieuse des nombreux geysers qui font la réputation du parc. Or, non seulement il n’en est rien, ces geysers ayant souvent servi de cadre à des rituels saisonniers, mais en outre un groupe d’environ quatre-cents Tukadika, une branche des Shoshone du nord, résidait de façon permanente dans le périmètre du parc et en fut déporté manu militari dix ans après sa création vers la réserve de Wind River, épisode peu glorieux que les brochures du National Park Service se gardent bien de mentionner ». Pour sauver le vivant non humain, on a chassé les Indiens Tukadika… (ajout du 2 juillet 2025)
[1] Texte paru dans La vie des idées, 21 janvier 2008.
Enfin, l’humain serait selon Wolff « le seul à pouvoir être décentré », à avoir un point de vue écologique global et pas seulement celui de l’espèce (a-t-on vu des non-humains se soucier des autres espèces et de l’environnement comme tels ?). Selon Wolff, « l’anthropocentrisme est non seulement souhaitable, il est inévitable ». Quant au biocentrisme, il repose selon le philosophe sur un argument fallacieux, un sophisme : la confusion entre valeur intrinsèque et valeur absolue. Vivre est une valeur intrinsèque pour un vivant en particulier, mais pas pour les autres vivants. La vie du coronavirus n’est pas une valeur intrinsèque pour les humains. Il l’est donc pour lui, mais pas dans l’absolu. Ce qui est « oublié », c’est la relation entre les vivants, la dimension systémique.
Et enfin, puisque la nature est gravement menacée, elle apparaît pour certains comme « forcément bonne » si elle était intacte ! Mais en réalité, elle ne l’est pas. La nature peut être dangereuse, écocidaire, source de destruction et de domination entre espèces. Dans un autre registre – ici c’est nous qui ajoutons –, ce n’est pas parce que la prolétariat (ou les peuples dominés par l’exploitation coloniale, les femmes par le patriarcat, etc.) est spolié, qu’il est « bon en soi » une fois libéré. Voir La ferme des animaux d’Orwell. La fin du colonialisme occidental (il y en a d’autres) n’a pas nécessairement abouti au meilleur des mondes. Cela se saurait.

Livre d’Orwell avec couverture de James Ensor
(source Gallimard)
Éthique vis-à-vis des autres vivants
Comme nous l’avons vu, la notion de vivant est ambigüe : elle désigne tantôt tel ou tel vivant particulier (comme une espèce ou un individu issu de celle-ci), « les êtres vivants » ; tantôt le vivant dans sa globalité diverse comme écosystème ou biosphère. Le slogan « il faut cesser de maltraiter le vivant » peut dès lors vouloir dire deux choses très différentes : ne pas maltraiter le vivant non humain en tant qu’espèce singulière (ce que l’on nomme l’antispécisme) ; veiller au maintien des écosystèmes globaux (climat, ressources, biodiversité, déchets…).
Sous une apparente coalition unitaire se cachent d’inévitables oppositions et conflits : protéger des écosystèmes peut nécessiter de combattre des espèces, végétales ou animales (comme les lapins en Australie), voire de réintroduire des prédateurs ; et inversement (protéger les animaux des réserves naturelles au Botswana – pour les touristes et l’économie du pays – nécessite de « chasser » les paysans locaux). L’éthique animale n’est pas nécessairement compatible avec l’éthique environnementale.
Pour Wolff, « Le concept de « vivant » permet de balayer la poussière de leurs conflits sous le tapis ». On ne peut, par ailleurs, « porter secours à toutes les bêtes sauvages qui, dans la nature, souffrent de la nature ». Car la nature maltraite la nature… « Tous les vivants », écrit ironiquement Wolff, ne sont pas comme nous « épris de liberté politique, d’analgésiques et de soins palliatifs ». Il faut donc arbitrer entre « la logique des vivants » (l’éthique animale, notamment) et « la logique du vivant » (l’éthique environnementale). Un « garde-fou, une limite, un fondement » est dès lors nécessaire. Ce ne peut être que l’humanité », conclut Wolff.
L’éthique animale peut se présenter sous la forme « welfare » (améliorer le sort des animaux, notamment ceux des élevages) ou « abolitionniste » (abolir l’élevage et tout usage d’animaux pour l’humain). Entre les deux, « différentes sortes de nuances de vert » – comme entre révolutionnaires radicaux et sociaux-démocrates réformistes –, bien évidemment. L’homme ne peut cependant pas mettre sur le même plan les rats et les nourrissons humains. Notons en passant que des animaux, comme certaines fourmis, pratiquent l’élevage, voire une forme d’agriculture.
Ce qui ne signifie pas, pour Wolff, que nous n’ayons pas des « contrats affectifs » avec des animaux de compagnie ou « domestiques » avec des animaux d’élevage. La proximité et les affinités ont leur rôle : nous éprouvons plus d’empathie pour notre chien que pour une bactérie. Nous n’avons en effet pas ce type de contrat avec les milliards de milliards d’animaux (ou autres formes du vivant) qui peuplent la terre, mais bien un « contrat écologique » avec l’ensemble de la planète, vivants ou non-vivants. Ici aussi, il convient de distinguer le particulier du global. L’homme est à la fois « une espèce superprédatrice de la planète et sa seule gardienne possible ». Notre responsabilité est immense en termes d’éthique environnementale (et certains en ont bien plus que d’autres).

Cahier de l’Herne consacré à Philippe Descola
(source éditeur)
Sauver l’humanité, pas « la planète » ou « le vivant »
En matière d’éthique écosystémique (climat et biodiversité en premier lieu), Wolff va émettre des positions anthropocentriques assez radicales, qui peuvent se résumer en une phrase : « Seule l’espèce humaine peut être affectée par le changement climatique ». Ce n’est pas « la planète » qu’il s’agit de sauver, ni les autres vivants : la première poursuivra sa ronde débarrassée des humains et les espèces vivantes s’adapteront ou muteront, voire regagneront du terrain après la disparition de l’humanité.
Ce centrage sur l’humanité ne diminue en rien, écrit Wolff, « notre responsabilité ; cela l’augmente, au contraire, puisqu’il dépend de nous, et de nous seuls, que la planète demeure vivable aujourd’hui et à terme pour les futures générations ». Mais, lui répond l’écologiste biocentré : « La biodiversité est en déclin sur toute la planète. N’est-ce pas une catastrophe en elle-même ? Ne faut-il pas défendre et sauvegarder le vivant dans son ensemble ? La biodiversité a bien une valeur en soi ».
Pour Wolff, « une éthique qui ferait de la biodiversité son principe et sa fin serait extravagante (…) cette éthique conduirait logiquement à l’abattage de 90 % de l’espèce superprédatrice : l’espèce humaine (…) Du point de vue de l’éthique du vivant en général, un recul massif de l’espèce humaine[4] serait la seule solution viable ! (…) Cependant, croyez-vous vraiment qu’il faille, afin de « sauver le vivant », sacrifier immédiatement 90 % de l’espèce humaine ? Cette mesure, dite « écofasciste », n’a certes jamais été prônée officiellement par un mouvement écologique (…) Ce serait pourtant le seul programme en accord avec les principes biocentristes. Les défenseurs du vivant l’assument-ils ? En ont-ils conscience ? ».
Il faut donc hiérarchiser, et cette éthique anthropocentrique est salutaire, y compris pour l’environnement. Elle ne peut d’ailleurs pas être totalement anthropocentrée. La biodiversité, non pas en nombre mais « en distance phylogénétique entre espèces et entre individus d’une même espèce », est essentielle à la survie des humains, mais également à la beauté de leur environnement. C’est aussi une valeur esthétique … que l’humanité lui donne (avec des variations culturelles). Elle n’est dès lors pas intrinsèque. « La biodiversité n’a d’autre valeur que celle que les humains lui accordent ». Et Wolff enfonce le clou : « L’humanité est donc la seule finalité de toute éthique environnementale. » (souligné par l’auteur)
Par conséquent, une éthique écologiste anthropocentrée doit être d’emblée humaine-sociale. Il ne doit pas y avoir de « politiques ou de mobilisations écologiques autonomes (…) Les luttes contre le changement climatique sont un chapitre du combat plus général contre les inégalités planétaires, régionales, sociales, ou sexuelles ». De plus, les crises environnementales sont planétaires et les politiques doivent l’être aussi. D’où, me semble-t-il (Wolff n’aborde pas sérieusement cet aspect), la nature profondément géopolitique et géoculturelle du combat écologique. Wolff, qui a le sens de la formule, fait cette observation : « On ne voit pas « le droit des animaux » de la même façon quand on promène son caniche sur les trottoirs d’une métropole et quand on pleure ses récoltes anéanties en quelques minutes par une invasion de criquets pèlerins ».
La personne humaine et sa valeur absolue
Wolff termine son livre par une réflexion argumentée sur les différences entre l’humanité et les autres espèces vivantes (même si la première fait évidemment partie de la nature). Il rappelle d’abord les « trois contrats » qui la lient aux vies non humaines : affectif, domestique et écologique. Sur ce dernier aspect, ce sont pas des « équilibres écologiques en eux-mêmes » que nous devons nous soucier, « car ce serait impossible sans sacrifier les vies humaines » comme nous l’avons vu.
Notre « contrat écologique », selon Wolff, est la recherche d’équilibres environnementaux « dans la seule mesure où ils garantissent la meilleure vie humaine à long terme ». Ce sont donc les équilibres écologiques pour l’humain. Dès lors, pourquoi toute vie humaine aurait-elle une valeur absolue ? Pourquoi faire une exception en sa faveur ? Et pourquoi toute ? Cette espèce invasive ne devrait-elle pas être liquidée ?
Wolff souligne d’abord que les désastres écologiques contemporains ne sont pas le fait de toute l’humanité, ni de l’Occident en général, mais bien du système productiviste capitaliste ou communiste (qu’il incrimine aussi le second mérite d’être souligné) depuis la révolution industrielle. Il rejette ensuite différentes caractéristiques de l’humanité ou de certaines parties d’entre elle qui ne lui semblent pas fondamentales (désir de justice pour les victimes, communauté morale de l’humanité, la raison, le langage pris isolément) pour ne retenir que « la raison dialogique ». Il s’agit de la capacité de raisonner en communiquant par le langage avec les autres humains. Tous les humains ont en partage cette faculté critique. Il s’agit dès lors de voir en quoi cette caractéristique est au fondement de l’humanité comme communauté morale.
La mystérieuse communauté morale des humains
Il s’agit évidemment du cœur de son argumentaire pour une écologie humaniste. La raison dialogique est la base de notre « nous », quelles que soient les différences individuelles ou collectives entre humains. C’est le « contrat moral d’humanité » qui s’ajoute aux autres avec le vivant, et qui fonde une écologie humaniste. Il suppose une éthique de réciprocité, aussi bafouée soit-elle dans l’histoire humaine : « Chacun s’efforcera de traiter tout autre comme il voudrait être traité par lui ». Wolff résume ce point fondamental : « Tel est le « contrat moral d’humanité ». C’est le premier contrat, celui de l’humanité avec elle-même. Il précède logiquement tout contrat noué avec les autres êtres naturels et donc les trois autres contrats. Il en est la condition et le fondement. »
Dans ce contexte, il faut veiller aux humains, notamment aux humains à venir, aux générations futures. Pour cela, il ne suffit pas de sauver le vivant en général, il faut sauver les conditions nécessaires à la vie : l’eau, l’atmosphère, le sol… Si l’on y ajoute le vivant, cela se nomme tout simplement « la nature ». N’ayant pas peur du mot. Quant à « nous », nous ne sommes pas que des vivants mais aussi des personnes. La transplantation cardiaque évoquée en début de volume, bien entendu rendue possible par les progrès de la médecine et par son financement, est pour Wolff une illustration de cette communauté morale des personnes humaines, pas de la « vie nue ».
Bernard De Backer, juin 2025
Addendum
Francis Wolff consacre son chapitre final à tenter d’expliquer l’inflation actuelle du « vivant » et « le tour antihumaniste pris par la pensée dominante de l’écologie politique ». Nous n’avons pas voulu rallonger inutilement cette recension, mais la question étant intéressante, nous plaçons le cœur de ses réflexions sur ce sujet dans cet ajout. Pour Wolff, « l’humanité et même la nature s’insèrent difficilement dans la nouvelle grille conceptuelle érigée par « la gauche » pour tenter de devenir écologiste », car en deux siècles « la nature est passée à gauche » et il lui fallait donc changer de nom. Quant à « l’humanité », elle serait passée à droite, ce qui la contraint à changer de visage.
Le déclin de l’humanité associé à celui des monothéismes (en Europe) est religieux, mais il est aussi philosophique – rejet de la notion essentialiste de « nature humaine », pour faire court -, ainsi que la conséquence des sciences humaines, associées aux découvertes de l’éthologie en matière de comportement animal. Le concept de « domination » a servi de base à un nouveau récit émancipateur pour le vivant non humain. Alors que l’apologie de la nature était un argument de droite, voire d’extrême droite (Barrès, Heidegger…), et que l’éloge du progrès industriel et de la ville dont « l’air rend libre » (Max Weber) était de gauche, les places politiques ont permuté. Ce sont les partis populistes et d’extrême droite qui sont le plus adversaires des mesures écologistes, et c’est la gauche, voire l’extrême gauche, qui s’est « verdie ». Mais le peuple a tendance à voter populiste.
La notion de domination s’est substituée à celle d’exploitation et le champ de son application s’est considérablement élargi, allant des humains dans toutes leurs caractéristiques (genre, couleur de peau, orientation sexuelle, handicap, position sociale, religion…) aux non-humains. La mise en évidence par des anthropologues (Descola au premier chef) de cosmologies prémodernes occidentales qui attribuent une « intériorité » aux existants non humains a complété le tableau en élargissant la domination à celle de tous les vivants et en disqualifiant la distinction nature-culture. Bref, « l’homme blanc occidental » est apparu comme le dominateur par excellence, notamment des autres manifestations du vivant. C’est l’extension de la pensée décoloniale. Mais ce combat se fait sans les classes populaires. Voilà pourquoi, selon l’ancien porte-parole de Greenpeace France (Clément Sénéchal), « l’écologie perd toujours » (aux élections). Ou, du moins, une certaine forme d’écologie.
Écouter : « Le grand renoncement écologique« , L’heure du Monde 2 juillet 2025
Complément du 6 décembre 2025. Faut-il en finir avec la nature ? La question qui divise les penseurs de l’écologie, Le Monde du 6 décembre. Le débat fait rage chez les écologistes entre « descolatouristes » (Philippe Descola + Bruno Latour) comme Baptiste Morizot, Nastassja Martin et Vinciane Deprez, et les défenseurs de l’idée de nature comme Francis Wolff (curieusement pas cité).
Complément du 18 juillet 2025. Comment le vivant peut nous sauver, podcast le Monde en six épisodes.
Sources (voir également les bibliographies associées sur Routes et déroutes)
- Dupouey Patrick, Pour ne pas en finir avec la nature, Agone, 2024
- Gauchet Marcel, « Sous l’amour de la nature la haine de l’homme », Le Débat, mai-août 1990
- Sénéchal Clément, Pourquoi l’écologie perd toujours, Seuil, 2024
- Truong Nicolas, « Les penseurs du vivant », Le Monde, été 2021 (12 articles successifs)
- Wolff Francis, Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences, Fayard, 2010
- Wolff Francis , La vie a-t-elle une valeur ?, Philosophie magazine éditeur, 2025
- Wolff Francis, « Tous les vivants ne se valent pas » avec Francis Wolff, France Inter, 22 mars 2025 (à partir de la minute 28)
- Wolff Francis : « Les pensées du vivant sont intenables et inefficaces face à l’ampleur du désastre écologique », interview par Florent Georgesco dans Le Monde du 5 avril 2025 (« entretien avec un écologiste inattendu »)
Sur Routes et déroutes
- Descola, le refus de l’histoire ? (recension de Les formes du visible)
- Voyage au Wokistan (Descola également « woke »)
- Une anthropologue fauve (sur deux livres de Nastassja Martin)
- L’écosophie pistée (sur Manières d’être vivant de Baptiste Morizot)
- Extension du décolonial (sur la pensée décoloniale, dont Descola)
- L’arbre qui cache la forêt (sur la passion contemporaine des arbres)
- Par-delà nature et culture (recension du livre de Descola pour Etopia et La Revue nouvelle)
[1] Le vivant y est parfois écrit avec une majuscule, comme dans ce numéro de printemps 2025 de la newsletter Poivre et sel de l’association Grands-Parents pour le Climat Belgique (dont je suis membre) : « Lors de l’assemblée générale du mois de juin, les membres avaient manifesté leur désir d’aborder la dimension philosophique de la transition et entre autres notre « reconnexion » avec le Vivant, lors des Midis du climat, en alternance avec les solutions pratiques pour adapter notre mode de vie. » (Thérèse Snoy, p. 3, je souligne) On peut aussi y lire dans le même numéro, sous la plume de Godelieve Ugeux (p. 18) : « Penser l’avenir, c’est penser l’humanité comme un nœud de relations avec le reste du monde vivant. Baptiste Morizot veut en finir avec notre sentiment d’impuissance. Dans une puissante réflexion, il propose un levier d’action écologique. » Le livre de Morizot est Raviver les braises du vivant, Acte sud, 2024.
[2] Wolff consacre deux longues notes en fin de volume à Descola et d’autres auteurs de la même école de pensée (Latour, Morizot, Nastassja Martin, Viveiros de Castro et la nébuleuse des « penseurs du vivant » comme les a définis le journaliste Nicolas Truong dans Le Monde en 2021). C’est dans cette note que Wolff écrit la phrase que j’ai placée en épigraphe de cet article : « … à force de vouloir expulser l’humanité de sa position dominante dans la nature, on finit par prêter à toute la nature les propriétés les plus convenues de l’humanité – quand ce ne sont pas les apologies du bon sauvage ou de la Terre-Mère. » Comme je l’avais constaté sur base des énoncés de Descola lui-même, toutes les ontologies non naturalistes sont anthropocentriques dans la mesure où elles prêtent aux non-humains des caractéristiques humaines. L’homme étant, selon Descola, « le gabarit de référence ».
[3] Comme je l’ai montré ailleurs, les ontologies non naturalistes dégagées par Philippe Descola (animisme, totémisme, analogisme) sont toutes anthropocentristes. Elles prêtent, elles aussi, « à toute la nature les propriétés les plus convenues de l’humanité » (Wolff)
[4] Rappelons que le rapport Meadows, Les limites à la croissance (1972), parlait aussi de la croissance démographique, une variable souvent peu prise en compte par les écologistes.

J’ai fait une première lecture attentive…tout ce dont Wolf parle ou fait allusion est tellement complexe ..points de vue diversifiés incompatibles entre eux politisés plus exactement populistes..impossible pour moi de prendre une position déterminée et univoque..j aimerais avoir TON avis Bernard..si possible amicalement
J’aimeJ’aime
Chère Marianne, j’ai évité, autant que faire ce peut, de donner mon point de vue dans cette recension. Sauf lorsque je l’avais déjà fait, notamment au sujet de Morizot et de Descola (ou de la passion contemporaine moderne pour les arbres). Le sujet n’est pas simple, l’exposé de Wolff parfois complexe. Il n’empêche que, si je le rejoins sur de nombreux points, dont le caractère « peu efficace » de l’écologie profonde 2.0 face aux défis écosystémiques contemporains (notamment électoralement), les recherches dans le domaine de l’éthologie nous indiquent que les autres vivants, surtout les animaux, ne sont pas des machines sans « intériorité ». D’autre part, les travaux minutieux de Descola ont le mérite de relativiser notre ontologie naturaliste, même si l’anthropologue – qui est aussi un militant – a tendance à prendre parti contre cette dernière et vouloir « décoloniser notre cosmologie ». C’est pour cela que je l’ai associé à l’idéologie décoloniale, voire au « wokisme ». À mon sens, il s’agit plutôt d’enrichir et d’élargir notre vision du monde sur base des acquis scientifiques (dont ceux de Descola). Mais, avant toute chose, il faut, pour notre survie et notre plaisir de vivre, continuer d’agir collectivement et individuellement (par atténuation et adaptation) contre les menaces écologiques majeures – qui risquent d’atteindre un point de non-retour, une fois prises dans une spirale incontrôlable.
J’aimeJ’aime